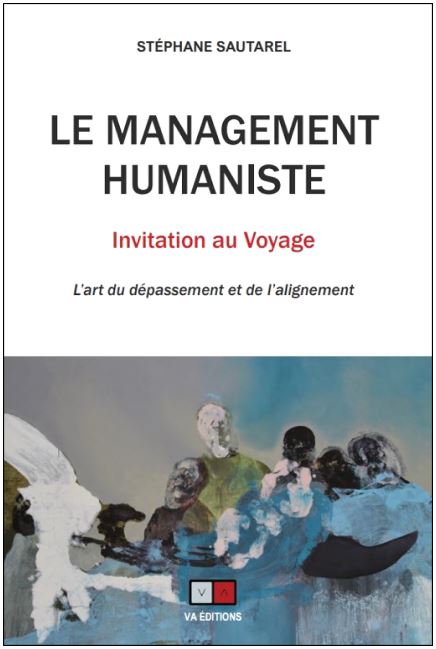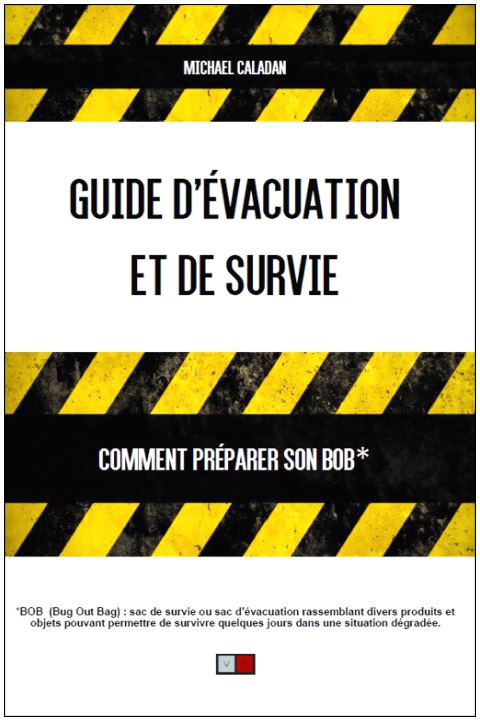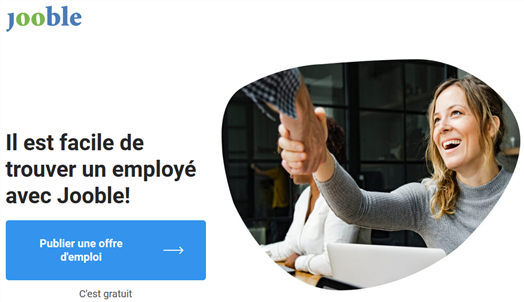Le débat sur le traçage est ouvert. Le débat entre la vision « orientale » d’un capitalisme numérique qui permet de tout savoir sur chacun et une vision « occidentale » qui cherche l’acception, l’introuvable équilibre, a déjà débuté. C’est à cette question précipitée de manière accélérée par la crise sanitaire : Comment rester libre ? dans la mesure où l’on n’a pas renoncé à le demeurer, que je vous invite à réfléchir pour ne pas en être seulement spectateur.
À propos des années 20, des années 1920, Stefan Zweig écrivait dans « Le monde d’hier » : « Ne croyez pas tout ce qu’on vous raconte. N’oubliez pas, dans tout ce qu’on vous montre, qu’il y a aussi beaucoup de choses qu’on ne vous montre pas. Rappelez-vous que la plupart du temps les gens qui parlent avec vous ne vous disent pas ce qu’ils voudraient vous dire, mais uniquement ce qu’on les autorise à vous dire… Votre téléphone est sur écoute, chacun de vos pas est contrôlé. »
Ce climat des années 20 en Europe, n’est-il pas un peu le climat de nos années 20 à l’échelle du monde ? Stéphane Audoin-Rouzeau, historien de la guerre de 1914-1918, ne dit pas autre chose et juge que nous sommes entrés avec cette crise sanitaire dans un « temps de guerre » et un moment de rupture anthropologique : « Nous ne reverrons jamais le monde que nous avons quitté il y a un mois ».
« Tous les problèmes de l’homme qui ne veut pas que son époque l’empêche d’être humain se résument à une seule question : comment rester libre ? […] Comment garder intacte l’humanité du cœur au milieu de la bestialité ». C’est le message que nous délivre aussi Stefan Zweig dans son essai sur Montaigne qui nous montre comment Montaigne s’était lui-même si bien libéré, lui qui était à tout instant « disposé à se prêter, à se donner, jamais ». « Car seul celui qui reste libre de tous et de tout accroît et préserve la liberté sur terre ».
Pour ne pas sacrifier toutes les libertés au nom du principe de précaution, il faut se référer à la notion de proportionnalité et de transparence de l’information que seules les démocraties peuvent offrir. C’est une frontière fragile, comme toutes les frontières. Comme le dit Mario Vargas Llosa : « le coronavirus ravit tous les ennemis de la liberté ». Il est le prétexte idéal pour la réduire et permettre à l’État d’intervenir dans nos vies. Certes le risque est plus fort en Chine qu’en France, me direz-vous.
On peut tomber d’accord sur cette nuance certes essentielle, mais qui ne vaut qu’à un instant donné. Les plus grandes démocraties : Grande-Bretagne et États-Unis, ne nous inquiètent-elles pas dans le choix de leurs dirigeants et de leur politique. Le populisme a plusieurs visages et tout pas vers une société de surveillance totalitaire est à proscrire. Succombant à leurs démons intérieurs, même les démocraties peuvent se changer en dictatures au nom de la protection de la santé, en proie aux peurs. Si l’être que je suis peut-être transformé en un ensemble d’informations, de données qui peuvent être gérées à distance plutôt qu’en face-à-face, alors je peux être soigné, éduqué, diverti sans avoir besoin de sortir de chez moi… La numérisation de tout ce qui peut l’être est le moyen pour le capitalisme du XXIe siècle d’obtenir de nouvelles baisses de coût… Le confinement actuel utilise massivement ces techniques. Cette crise apparaîtra peut-être comme un moment d’accélération de cette virtualisation du monde.
Ce serait alors comme le point d’inflexion du passage du capitalisme industriel au capitalisme numérique et de son corollaire l’effondrement des promesses humanistes de la société postindustrielle. Si l’après-crise ne sera pas identique à l’avant, si nous ne reprenons pas les choses là où nous les avons laissées, cet après peut être pire si nous ne nous montrons pas vigilants avec les « globalisateurs », avec ceux qui déjà nous expliquent qu’il faut aller plus loin.
Le mot crise vient du grec krisis, qui signifie non pas la catastrophe, mais le dénouement, heureux ou malheureux. La crise, c’est la situation critique qui peut conduire au pire, comme au meilleur. Voilà de quoi nous aider à envisager la crise comme n’étant pas le résultat d’une fatalité qui nous rendrait impuissants, mais comme le moment où nous sommes plus que jamais responsables des événements, libres d’agir.
Autrement dit, la crise, ce n’est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. C’est donc la liberté que nous avons d’en faire quelque chose. Renoncer à cette liberté serait pire que tout. Écoutons le poète, écoutons Pessoa, nous rappeler que de tout, il resta trois choses :
« De tout, il resta trois choses :
La certitude que tout était en train de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,
la certitude que cela serait interrompu avant que d’être terminé.
Faire de l’interruption, un nouveau chemin,
faire de la chute, un pas de danse,
faire de la peur, un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche…
une rencontre. »
Dans « Les Essais », Montaigne, peut-être le plus formidable des humanistes, nous enseigne que seule compte la liberté intérieure. Pour ma part, je me suis fait une promesse, dès que la liberté d’aller et de venir nous sera rendue et que nous saurons l’exercer avec modération et responsabilité, et non plus pour faire sans raison le tour de notre planète épuisée : Aller passer quelques heures devant « Le Concert », à Antibes, le dernier tableau peint par Nicolas de Staël.
Je suis certain d’y ressentir comme un souffle, un souffle d’absolu venu d’ailleurs et terriblement humain. C’est cette liberté qui peut aussi ouvrir à des crises, à la mort, comme cette œuvre unique ou cette œuvre ultime. À ce titre, la crise que nous traversons appelle plus que jamais la littérature. Nous avons besoin de témoignages. Lire est un des derniers bastions de subversion : Pérez Galdos, Flaubert, Zweig et tant d’autres. « L’être humain pense à travers des récits plutôt qu’avec des faits », la construction d’un nouveau récit collectif passe par l’évaluation de nos réussites passées, la prise en compte honnête de la mesure des dangers et de notre rôle pour y faire face. La liberté s’accompagne de la responsabilité, c’est peut-être pour cela que nous pouvons y renoncer au prétexte de garantir notre santé.
Cette responsabilité, notre responsabilité d’affronter non seulement le coronavirus, mais aussi la crise écologique peut nous faire peur, alors qu’elle nous offre une nouvelle chance. Dans une époque de crise, il est nécessaire que les intellectuels, les écrivains, fassent de la politique « créativement », pour faire en sorte que l’avenir respecte nos désirs et pour sortir des slogans et de la dévaluation permanente du contenu.
Parce que vivre ne suffit pas, pour paraphraser Pessoa, l’art est plus que jamais une nécessité dans ce moment où la science semble prévaloir. La science montre chaque jour ses limites, ses débats, ses incertitudes, et d’une certaine façon c’est tant mieux. Et nous en avons bien sûr grand besoin.
Nous restons des êtres biologiques et nos sociétés subissent aujourd’hui un choc anthropologique de tout premier ordre. Elles ont tout fait pour bannir la mort de leurs horizons d’attente, elles se fondaient de manière croissante sur la puissance du numérique et les promesses de l’intelligence artificielle. Mais nous sommes rappelés à notre animalité fondamentale, au « socle biologique de notre humanité » comme l’appelait l’anthropologue Françoise Héritier. Nous restons des homo-sapiens appartenant au monde animal, attaquables par des maladies contre lesquelles les moyens de lutte demeurent rustiques en regard de notre puissance technologique supposée : rester chez soi, sans médicament, sans vaccin… Est-ce très différent de ce qui se passait à Marseille pendant la peste de 1720 ?
Ce rappel incroyable de notre substrat biologique se double d’un autre rappel, celui de l’importance de la chaîne d’approvisionnement, déficiente pour les médicaments, les masques ou les tests, mais qui fonctionne pour l’alimentation, sans quoi ce serait très vite la dislocation sociale et la mort de masse. C’est une leçon d’humilité dont sortiront peut-être, à terme, de bonnes choses, mais auparavant, il va falloir faire face à nos dénis.
Cette fois, on a le plus grand mal à penser « l’après », même si on s’y essaie, parce qu’on sait qu’on ne sera pas débarrassés de ce type de pandémie, même une fois la vague passée. On redoutera la suivante. Or, rappelons que le Covid-19 a jusqu’ici une létalité faible par rapport au Sras ou à Ebola. Mais imaginons qu’au lieu de frapper particulièrement les plus âgés, il ait atteint en priorité les enfants ?… Nos sociétés se trouveraient déjà en situation de dislocation sociale majeure.
La fameuse phrase de Paul Valéry, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles », dit quelque chose de très profond sur l’effondrement de la croyance en un monde meilleur. C’était déjà il y a cent ans, au cours de ces années 20…
Le président allemand, dont la parole est rare, a réalisé ce samedi une allocution télévisée, rendant notamment hommage aux « piliers invisibles » de la société allemande. Frank-Walter Steinmeier a marqué les esprits en utilisant un champ lexical opposé à celui jusqu’alors utilisé par le Président français Emmanuel Macron, qui, martial, avait martelé à la télévision française mi-mars être « en guerre » contre la pandémie, reprenant notamment le vocabulaire de Clémenceau durant la Première Guerre mondiale. « Non, cette pandémie n’est pas une guerre. Les nations ne s’opposent pas à d’autres nations, les soldats à d’autres soldats. C’est un test de notre humanité », a-t-il ainsi assuré.
Il n’y a pas d’humanité sans liberté, il n’y a pas d’humanisme sans esprit libre : « le siège de l’âme est là où le monde intérieur touche le monde extérieur », comme nous le rappelle le jeune poète allemand Novalis. Cette oscillation, trop longtemps oubliée, est liberté.
Stéphane Sautarel
À propos des années 20, des années 1920, Stefan Zweig écrivait dans « Le monde d’hier » : « Ne croyez pas tout ce qu’on vous raconte. N’oubliez pas, dans tout ce qu’on vous montre, qu’il y a aussi beaucoup de choses qu’on ne vous montre pas. Rappelez-vous que la plupart du temps les gens qui parlent avec vous ne vous disent pas ce qu’ils voudraient vous dire, mais uniquement ce qu’on les autorise à vous dire… Votre téléphone est sur écoute, chacun de vos pas est contrôlé. »
Ce climat des années 20 en Europe, n’est-il pas un peu le climat de nos années 20 à l’échelle du monde ? Stéphane Audoin-Rouzeau, historien de la guerre de 1914-1918, ne dit pas autre chose et juge que nous sommes entrés avec cette crise sanitaire dans un « temps de guerre » et un moment de rupture anthropologique : « Nous ne reverrons jamais le monde que nous avons quitté il y a un mois ».
« Tous les problèmes de l’homme qui ne veut pas que son époque l’empêche d’être humain se résument à une seule question : comment rester libre ? […] Comment garder intacte l’humanité du cœur au milieu de la bestialité ». C’est le message que nous délivre aussi Stefan Zweig dans son essai sur Montaigne qui nous montre comment Montaigne s’était lui-même si bien libéré, lui qui était à tout instant « disposé à se prêter, à se donner, jamais ». « Car seul celui qui reste libre de tous et de tout accroît et préserve la liberté sur terre ».
Pour ne pas sacrifier toutes les libertés au nom du principe de précaution, il faut se référer à la notion de proportionnalité et de transparence de l’information que seules les démocraties peuvent offrir. C’est une frontière fragile, comme toutes les frontières. Comme le dit Mario Vargas Llosa : « le coronavirus ravit tous les ennemis de la liberté ». Il est le prétexte idéal pour la réduire et permettre à l’État d’intervenir dans nos vies. Certes le risque est plus fort en Chine qu’en France, me direz-vous.
On peut tomber d’accord sur cette nuance certes essentielle, mais qui ne vaut qu’à un instant donné. Les plus grandes démocraties : Grande-Bretagne et États-Unis, ne nous inquiètent-elles pas dans le choix de leurs dirigeants et de leur politique. Le populisme a plusieurs visages et tout pas vers une société de surveillance totalitaire est à proscrire. Succombant à leurs démons intérieurs, même les démocraties peuvent se changer en dictatures au nom de la protection de la santé, en proie aux peurs. Si l’être que je suis peut-être transformé en un ensemble d’informations, de données qui peuvent être gérées à distance plutôt qu’en face-à-face, alors je peux être soigné, éduqué, diverti sans avoir besoin de sortir de chez moi… La numérisation de tout ce qui peut l’être est le moyen pour le capitalisme du XXIe siècle d’obtenir de nouvelles baisses de coût… Le confinement actuel utilise massivement ces techniques. Cette crise apparaîtra peut-être comme un moment d’accélération de cette virtualisation du monde.
Ce serait alors comme le point d’inflexion du passage du capitalisme industriel au capitalisme numérique et de son corollaire l’effondrement des promesses humanistes de la société postindustrielle. Si l’après-crise ne sera pas identique à l’avant, si nous ne reprenons pas les choses là où nous les avons laissées, cet après peut être pire si nous ne nous montrons pas vigilants avec les « globalisateurs », avec ceux qui déjà nous expliquent qu’il faut aller plus loin.
Le mot crise vient du grec krisis, qui signifie non pas la catastrophe, mais le dénouement, heureux ou malheureux. La crise, c’est la situation critique qui peut conduire au pire, comme au meilleur. Voilà de quoi nous aider à envisager la crise comme n’étant pas le résultat d’une fatalité qui nous rendrait impuissants, mais comme le moment où nous sommes plus que jamais responsables des événements, libres d’agir.
Autrement dit, la crise, ce n’est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. C’est donc la liberté que nous avons d’en faire quelque chose. Renoncer à cette liberté serait pire que tout. Écoutons le poète, écoutons Pessoa, nous rappeler que de tout, il resta trois choses :
« De tout, il resta trois choses :
La certitude que tout était en train de commencer,
la certitude qu’il fallait continuer,
la certitude que cela serait interrompu avant que d’être terminé.
Faire de l’interruption, un nouveau chemin,
faire de la chute, un pas de danse,
faire de la peur, un escalier,
du rêve, un pont,
de la recherche…
une rencontre. »
Dans « Les Essais », Montaigne, peut-être le plus formidable des humanistes, nous enseigne que seule compte la liberté intérieure. Pour ma part, je me suis fait une promesse, dès que la liberté d’aller et de venir nous sera rendue et que nous saurons l’exercer avec modération et responsabilité, et non plus pour faire sans raison le tour de notre planète épuisée : Aller passer quelques heures devant « Le Concert », à Antibes, le dernier tableau peint par Nicolas de Staël.
Je suis certain d’y ressentir comme un souffle, un souffle d’absolu venu d’ailleurs et terriblement humain. C’est cette liberté qui peut aussi ouvrir à des crises, à la mort, comme cette œuvre unique ou cette œuvre ultime. À ce titre, la crise que nous traversons appelle plus que jamais la littérature. Nous avons besoin de témoignages. Lire est un des derniers bastions de subversion : Pérez Galdos, Flaubert, Zweig et tant d’autres. « L’être humain pense à travers des récits plutôt qu’avec des faits », la construction d’un nouveau récit collectif passe par l’évaluation de nos réussites passées, la prise en compte honnête de la mesure des dangers et de notre rôle pour y faire face. La liberté s’accompagne de la responsabilité, c’est peut-être pour cela que nous pouvons y renoncer au prétexte de garantir notre santé.
Cette responsabilité, notre responsabilité d’affronter non seulement le coronavirus, mais aussi la crise écologique peut nous faire peur, alors qu’elle nous offre une nouvelle chance. Dans une époque de crise, il est nécessaire que les intellectuels, les écrivains, fassent de la politique « créativement », pour faire en sorte que l’avenir respecte nos désirs et pour sortir des slogans et de la dévaluation permanente du contenu.
Parce que vivre ne suffit pas, pour paraphraser Pessoa, l’art est plus que jamais une nécessité dans ce moment où la science semble prévaloir. La science montre chaque jour ses limites, ses débats, ses incertitudes, et d’une certaine façon c’est tant mieux. Et nous en avons bien sûr grand besoin.
Nous restons des êtres biologiques et nos sociétés subissent aujourd’hui un choc anthropologique de tout premier ordre. Elles ont tout fait pour bannir la mort de leurs horizons d’attente, elles se fondaient de manière croissante sur la puissance du numérique et les promesses de l’intelligence artificielle. Mais nous sommes rappelés à notre animalité fondamentale, au « socle biologique de notre humanité » comme l’appelait l’anthropologue Françoise Héritier. Nous restons des homo-sapiens appartenant au monde animal, attaquables par des maladies contre lesquelles les moyens de lutte demeurent rustiques en regard de notre puissance technologique supposée : rester chez soi, sans médicament, sans vaccin… Est-ce très différent de ce qui se passait à Marseille pendant la peste de 1720 ?
Ce rappel incroyable de notre substrat biologique se double d’un autre rappel, celui de l’importance de la chaîne d’approvisionnement, déficiente pour les médicaments, les masques ou les tests, mais qui fonctionne pour l’alimentation, sans quoi ce serait très vite la dislocation sociale et la mort de masse. C’est une leçon d’humilité dont sortiront peut-être, à terme, de bonnes choses, mais auparavant, il va falloir faire face à nos dénis.
Cette fois, on a le plus grand mal à penser « l’après », même si on s’y essaie, parce qu’on sait qu’on ne sera pas débarrassés de ce type de pandémie, même une fois la vague passée. On redoutera la suivante. Or, rappelons que le Covid-19 a jusqu’ici une létalité faible par rapport au Sras ou à Ebola. Mais imaginons qu’au lieu de frapper particulièrement les plus âgés, il ait atteint en priorité les enfants ?… Nos sociétés se trouveraient déjà en situation de dislocation sociale majeure.
La fameuse phrase de Paul Valéry, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles », dit quelque chose de très profond sur l’effondrement de la croyance en un monde meilleur. C’était déjà il y a cent ans, au cours de ces années 20…
Le président allemand, dont la parole est rare, a réalisé ce samedi une allocution télévisée, rendant notamment hommage aux « piliers invisibles » de la société allemande. Frank-Walter Steinmeier a marqué les esprits en utilisant un champ lexical opposé à celui jusqu’alors utilisé par le Président français Emmanuel Macron, qui, martial, avait martelé à la télévision française mi-mars être « en guerre » contre la pandémie, reprenant notamment le vocabulaire de Clémenceau durant la Première Guerre mondiale. « Non, cette pandémie n’est pas une guerre. Les nations ne s’opposent pas à d’autres nations, les soldats à d’autres soldats. C’est un test de notre humanité », a-t-il ainsi assuré.
Il n’y a pas d’humanité sans liberté, il n’y a pas d’humanisme sans esprit libre : « le siège de l’âme est là où le monde intérieur touche le monde extérieur », comme nous le rappelle le jeune poète allemand Novalis. Cette oscillation, trop longtemps oubliée, est liberté.
Stéphane Sautarel

 Éditorialistes & Contributeurs
Éditorialistes & Contributeurs Corporate management
Corporate management